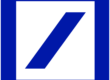On a beaucoup dénoncé la « finance de l’ombre », accusée d’un peu tous les maux et surtout d’avoir précipité la crise de 2008. Plus récemment, certains ont voulu cependant dédiaboliser le Shadow banking, expliquant qu’il remplit un rôle économique et représente la contrepartie d’activités bancaires trop contraintes et réglementées ; tout en soulignant qu’aucune réglementation n’est d’impact neutre, notamment quant aux innovations qu’elle suscite pour la contourner.
Le Shadow banking désigne des opérations financières assimilables à celles que des banques pourraient réaliser (crédits, dépôts, repos, …) mais qui ne sont pas initiées par des banques et ne sont donc pas soumises à la réglementation bancaire. Il n’y a en fait rien là de très mystérieux : le Shadow banking, ce sont des caisses de retraites, des compagnies d’assurance, des banques, des particuliers fortunés, des OPCVM, des entreprises disposant d’une trésorerie abondante qui, en quête d’une rémunération élevée, s’adressent à des hedge funds, à des fonds d’investissements ou de prêts, lesquels ne sont pas des banques. Partant, ces entités peuvent davantage prendre de risques que les banques et, de là, offrir des rendements plus élevés à l’argent qu’on leur confie – c’est le principe même des hedge funds. Dans la mesure où cela est clairement reconnu par ceux qui s’adressent à eux, où est exactement le problème ?
Certes, le Shadow banking utilise les paradis fiscaux (mais beaucoup plus que les grandes entreprises ?), il peut servir de réceptacle à l’évasion fiscale (la rend-il possible cependant ?). Il ne peut être question de débrouiller ici les nombreuses et diverses charges qu’on retient contre la « finance de l’ombre » ; dont il faut néanmoins souligner que l’appellation seule est à même de nourrir pas mal de fantasmes. Par ailleurs, les accusations relèvent souvent d’une condamnation morale (le Shadow banking est vu comme le temple de l’avidité et de la cupidité) qui nous éloigne des problématiques de la réglementation bancaire stricto sensu. Soulignons donc seulement que la finance parallèle est légale, sans être soumise à la supervision dont font l’objet les établissements bancaires.
Voici donc une activité qui échappe à toute vision précise d’ensemble mais qui a atteint une ampleur considérable (on parle de 25% des actifs gérés par l’ensemble du système financier) et qui ne s’est pas développée en parallèle des activités bancaires mais en connexion directe avec elles, notamment à travers la titrisation de crédits ou des prises en pensions (on le découvrit particulièrement avec les difficultés de Lehman Brothers et de MF Global). Par ailleurs, les banques peuvent accorder des lignes de liquidité aux véhicules de titrisation – en 2007 et 2008, le soutien (ruineux) de certaines banques envers ces véhicules alla parfois bien au-delà de leurs obligations contractuelles en tant qu’originateurs – et être liées à des hedge funds (ce fut le cas de Bear Stearns). Or tous ces prolongements des activités bancaires échappent à la supervision bancaire, malgré les risques qui leur sont attachés, jusqu’à la possibilité de contagions systémiques. Dès lors, les G 20 de 2010 et 2011 ont voulu couper les cordons entre les banques et le Shadow banking. Cela s’est notamment traduit par l’interdiction faite aux banques d’exercer directement des activités de négociation pour compte propre (Dodd Frank Act aux USA, récente loi bancaire française), ou de détenir des parts de hedge funds.
Il s’agit donc d’interdire le Shadow banking aux banques plutôt que d’interdire le Shadow banking. Souvent mal comprise, cette orientation est déterminante et le Shadow banking, dans le contexte d’une épargne mondiale surabondante à la recherche de meilleurs rendements, n’en représente finalement qu’un effet. C’est qu’il s’agit en effet de pousser à la désintermédiation financière et cette orientation n’est pas née de la crise. Elle est notamment ce que visait la MIF, adoptée dans son principe en 2004 et mise en œuvre en 2007 : faire baisser les coûts d’accès à la cotation boursière, en élargir le marché ainsi et le rendre plus accessible, en brisant le monopole des bourses. En regard et au même moment, avec Bâle II, les risques bancaires étaient cantonnés à une mesure statistique acceptable. Celle-ci n’ayant pas évité la crise de 2008, Bâle III enserre plus brutalement les crédits bancaires par des ratios de liquidité. Dans les deux cas, il s’est agi de recadrer l’activité des banques dans un rôle de conservateur de valeurs avant tout.
Aujourd’hui, cependant, on se rend compte que, pour le financement de l’économie, les marchés financiers ne remplacent pas si facilement les banques. Tandis que l’orientation même de la réglementation bancaire soulève deux grandes interrogations :
- Pourra-t-on vraiment, à côté des banques, laisser se développer une finance parallèle désintermédiée et porteuse de risques importants mais échappant aux normes prudentielles bancaires ? Cela ne sera-t-il pas remis en cause dès le premier choc d’importance, surtout si des investisseurs institutionnels s’y retrouvent piégés ?
- La réglementation bancaire est-elle vraiment suffisante pour évacuer les risques excédant une probabilité « normale » ? En quoi les banques françaises sont-elles aujourd’hui protégées d’un effondrement violent du marché immobilier ? Elles ne le sont que parce que cet effondrement n’a pas eu lieu…
Dans les deux cas, le développement d’une finance désintermédiée et l’appréciation des risques bancaires, ne se fie-t-on pas un peu candidement à la vertu régulatrice du marché de donner aux choses leur juste valeur ?
Guillaume ALMERAS/Score Advisor