En ce moment, les articles ne manquent pas qui alertent sur l’état inquiétant de la Deutsche Bank. Renouvellement du staff dirigeant sur un constat d’échec. Mise sous surveillance avec implication négative de la note à long terme (A-) de la banque par Standard & Poor’s. Cours de l’action frôlant le plus bas jamais atteint jusqu’ici. Beaucoup pointent le risque d’un Lehman bis, qui n’arrivera probablement pas. Parce que dans le cas d’une banque dont l’exposition sur produits dérivés a pu être estimée à 64 000 milliards $ – 16 fois le PIB allemand ! – l’expression « too big to fail » prend tout son sens. Pourtant, la faillite n’a-t-elle pas déjà eu lieu ?
Pas de dépôt de bilan donc – plutôt un atterrissage le plus en douceur possible, à travers des démembrements, fermetures et cessions d’activités, financés par la planche à billets de la BCE. Celle-ci a d’ailleurs demandé à Deutsche Bank de déterminer l’impact d’une vente de ses positions de trading. Une manière de commencer le chiffrage à la casse. Là où il risque d’être le plus important.
Pour autant, s’il n’y aura sans doute pas dépôt de bilan, c’est bien à une faillite à laquelle nous allons assister. A laquelle nous avons en fait déjà assistée. Faillite flagrante dans l’incapacité de l’équipe sortante à avoir repris la main sur un établissement en pleine fuite en avant depuis des années. Et faillite non moins notable de la supervision bancaire à prévenir et à endiguer ce genre de situation.
Dans les années 80, la Deutsche Bank, première banque allemande, était le fleuron d’un « modèle rhénan » de capitalisme financier particulièrement stable et puissant, que beaucoup admiraient alors en France. A l’époque, la plupart de ses dirigeants parlaient mal anglais et ses activités à Wall Street étaient très modestes. Cette époque se terminera symboliquement avec l’assassinat du PDG Alfred Herrhausen par la Fraction Armée rouge en 1989. Son successeur, Hilmar Kopper décidera ensuite de faire de l’établissement un poids lourd mondial de la banque d’investissement et il recrutera à prix d’or pour cela des équipes de la City et de Wall Street – archétype du trader triomphant, ancien de Merrill Lynch, Edson Mitchell sera ainsi embauché en 1995 avec cinquante collaborateurs.
A l’époque, avec des résultats florissants, le nouveau patron de Deutsche Bank, Josef Ackermann, accordera une grande liberté à des traders qui, en 2007, généraient plus de 70% des bénéfices – 25 milliards € entre 2001 et 2015. Sur la même période, Anshumain Jain, le successeur d’Edson Mitchell, mort dans un accident d’avion, aurait, selon Der Spiegel, gagné entre 300 et 400 millions €. Tout allait bien donc.
Ces résultats néanmoins dissimulaient une totale fuite en avant et les traders de Deutsche Bank furent bientôt sur tous les mauvais coups pour maintenir leurs résultats et leurs émoluments. Le groupe s’est ainsi retrouvé au total impliqué dans… 8 000 affaires judiciaires ! A ce point qu’il serait difficile de trouver un scandale financier qui ne le concerne pas. Manipulation du marché des devises, produits toxiques, détournements fiscaux, falsification de certificats d’émissions de CO2, non-respect des embargos américains, manipulation du Libor, etc., etc. A ceci s’ajoutèrent des investissements onéreux et peu judicieux, comme la reprise en 2009 du réseau de détail de Postbank, peu rentable, pour 6 milliards €.
A partir de 2015, l’alerte est sonnée. D’abord à travers le coût des litiges juridiques – depuis 2012, ils ont dépassé les 20 milliards €. L’année se solde par une perte de 6,8 milliards € et, l’année suivante, le FMI accusera l’établissement d’être la banque « qui contribue le plus aux risques systémiques pesant sur le système bancaire mondial ». Dès l’été 2015, John Cryan, ancien directeur financier d’UBS, est nommé. Tout de suite, s’il reconnait les « errements » du passé (a-t-il le choix !?) il met l’accent – de manière assez originale pour un patron de banque – sur l’état déplorable de ses systèmes d’information. Derrière ce constat, un autre pointe s’il n’est pas aussi formellement énoncé : l’établissement, en fait, n’est pas vraiment dirigé ; pas plus dans ses activités que dans ses moyens et ceci reflète cela. Les métiers ont été laissés libres en effet d’investir dans leurs propres technologies, sans coordination d’ensemble. Rien qu’à Londres, on compte plus de cent systèmes d’enregistrement différents pour les activités de trading. Conséquence immédiate : en 2015, Deutsche Bank a été incapable de fournir les données en réponse aux stress tests de la Fed. En revanche, sans aucune vision d’ensemble mais pour avoir l’impression de faire quelque chose et de limiter les coûts, les anciens dirigeants ont cédé à tous les mirages du cloud et de l’externalisation. John Cryan le déclare lui-même : la banque utilise 7 000 applications, dont 80% sont externalisées auprès de… 30 000 prestataires ! Et Cryan d’annoncer immédiatement que 20% des contrats (6 000 prestataires) ne seront pas renouvelés.
Personne ne tique. Pourtant, l’annonce est effarante ! Comment peut-on annoncer aussi rapidement de tels chiffres ? Sans dire à quoi ils engagent ? Comment un responsable peut-il être jugé crédible ce faisant ? Comment le superviseur peut-il rester apparemment de marbre ? C’est qu’on annonce la promotion d’un « expert » ; en l’occurrence Kim Hammonds, ancienne DSI de Boeing, chargée d’harmoniser les SI du Groupe. Très vite, ainsi, un plan est dressé : les systèmes d’exploitation internes devront passer de 45 à 4 d’ici 2020 (!). L’infrastructure sera virtualisée à 95% et le cloud privé adopté à 80% (pour cela, un contrat de dix ans a été signé avec HP en février dernier). Au total, 1 milliard € d’économies liées à la réduction du nombre de prestataires et 800 millions € de restrictions des dépenses informatiques, c’est-à-dire l’essentiel des 2,5 milliards € que le Groupe dans son ensemble s’est fixé pour objectif d’économiser.
Un plan efficace ? En 2015, Deutsche Bank avait versé par erreur 6 milliards $ à un Hedge Fund. Le mois dernier, elle a procédé à un virement erroné de 28 milliards € à la Bourse de Francfort pour un appel de marge sur ses produits dérivés… Après avoir déclaré que Deutsche Bank était « l’entreprise la plus dysfonctionnelle pour laquelle elle avait jamais travaillé », Kim Hammonds vient d’être remerciée, en même temps que John Cryan. Elle était parvenue à réduire les systèmes d’exploitation internes de 45 à… 32.
Le film ainsi déroulé, deux questions se posent inévitablement. La première consiste à savoir si Deutsche Bank est le seul établissement de sa taille dans une telle situation et la réponse – très inquiétante – est probablement non quoiqu’on puisse se demander si quelqu’un est vraiment en mesure d’y apporter une réponse un peu fondée. Un indice : aux Etats-Unis 43% des systèmes d’exploitation des principales banques et 80% de leurs transactions tournent sur des systèmes toujours écrits en… Cobol. Un langage informatique qui date des années 60 et des applications auxquelles on préfère ne pas toucher tant qu’elles marchent, dans la mesure où personne n’est capable d’estimer assez précisément les risques et impacts qu’il pourrait y avoir à les modifier et les remplacer (voir cet article). Autre manière de formuler les choses : y a-t-il un pilote dans l’avion !?
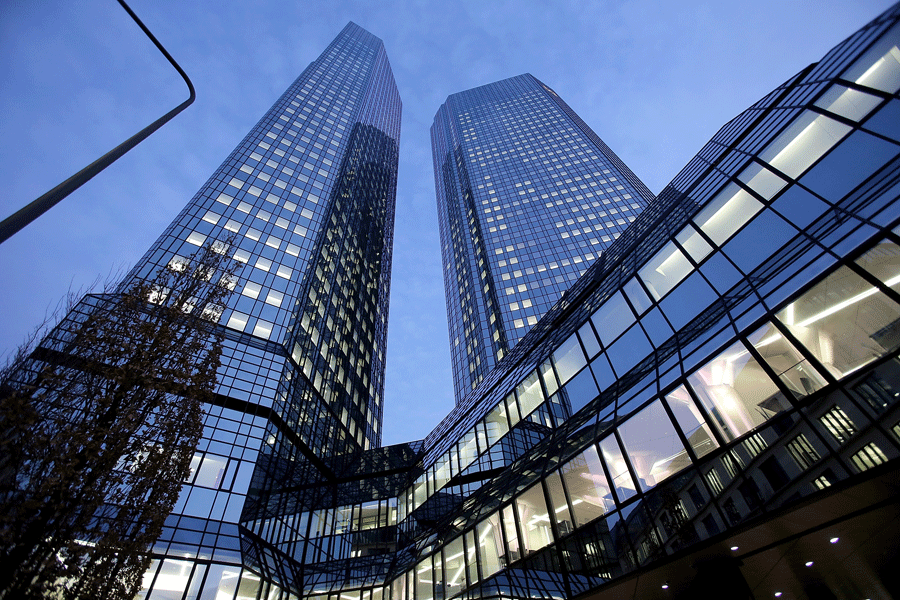
La seconde question concerne dès lors inévitablement les modalités d’une supervision bancaire essentiellement comptable et quantitative (et frappée de considérables limites à cet égard : approche statistique standard, modèles internes inauditables, règles de prudence abolies, …) quand à l’évidence se pose de manière flagrante un problème de management portant sur la maîtrise possible par les équipes dirigeantes des plus grandes banques de la diversité et de la complexité des activités et des moyens qu’elles sont sensées conduire et piloter. Une dimension que la supervision ignore à peu près complètement mais vis-à-vis de laquelle il faut bien, dans le cas de la Deutsche Bank, parler de faillite. Car au-delà des risques financiers et opérationnels, c’est bien la responsabilité des dirigeants successifs qui a été ici prise à défaut.
Enfin, ne négligeons pas l’aspect humain des choses. Bien sûr, nous ne parlons pas des 26 000 collaborateurs au moins du Groupe qui ont perdu ou perdront leur emploi dans l’affaire. Pour avoir totalement échoué à redresser Deutsche Bank, John Cryan – qui se contentait (il avait renoncé à tout bonus) d’un salaire de 3,9 millions € – part avec un parachute de 6,8 millions €. Dans d’assez bonnes conditions ainsi. On respire !
Score Advisor






